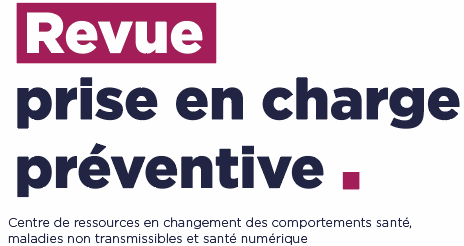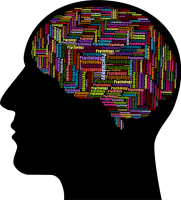En matière de santé et de comportements santé et d’évitement des maladies non transmissibles, le fossé se creuse de plus en plus chez les Français. Les réactifs d’un côté, dont les comportements santé sont majoritairement dus au biais d’évitement, et les plus « riches » d’après OpinionWay, qui sont eux plus proactifs pour leur santé. D’autre part, l’étude souligne un fossé profond entre l’intention et le passage à l’action. Des insights capitaux pour la prévention santé en France, en charge de l’évitement des maladies non transmissibles.
Conscience ne signifie pas action
92 % des Français affirment être convaincus de l’importance de prévenir plutôt que guérir, mais seulement 62 % déclarent réellement agir en ce sens.
Ce « gap » entre la conscience et l’action résume le dilemme français : un haut niveau de sensibilisation théorique, mais une faible traduction en comportements concrets.
Et ce décalage n’est pas anecdotique : il pèse directement sur la lutte contre les maladies non transmissibles (MNT) — ces pathologies chroniques qui représentent plus de 80 % des décès en France.
La prévention, une affaire de privilégiés ?
Premier constat frappant : 68 % des Français considèrent que la prévention est réservée aux plus favorisés, mieux informés et avec un meilleur accès aux soins. Ce sentiment traverse les classes sociales, mais il est encore plus marqué chez les 25-49 ans et les habitants des grandes agglomérations.
Ce résultat souligne une perception d’injustice structurelle : la prévention serait moins une question de volonté qu’une affaire de capital culturel et de disponibilité. Autrement dit, ceux qui auraient le plus besoin de prévention sont souvent ceux qui y ont le moins accès — faute de temps, de repères médicaux stables ou de lisibilité du système.
Ce biais socialement ancré crée un terrain fertile pour l’inaction.
La prévention demeure un acte administratif
Quand on interroge les Français sur leurs pratiques concrètes, la prévention reste essentiellement médicale et réactive :
- 77 % déclarent consulter leur médecin chaque année ;
- 60 % font une prise de sang ;
- 58 % se vaccinent ;
- 53 % participent aux dépistages organisés.
Mais ces chiffres cachent une réalité : la prévention française reste centrée sur le contrôle médical, pas sur le changement de comportements. Peu d’entre eux mentionnent une activité physique régulière, une alimentation équilibrée, ou un suivi numérique personnalisé — dimensions pourtant cruciales de la prévention moderne.
L’évitement des maladies devient ici un acte administratif de santé, pas un engagement de mode de vie.
Une culture du symptôme
Autre donnée clé : 61 % des Français n’agissent qu’à l’apparition de symptômes physiques, et 60 % lorsqu’un examen révèle des anomalies. En d’autres termes, la prévention intervient souvent trop tard, lorsqu’un signe d’alerte est déjà visible.
Ce comportement illustre une forme de prévention défensive, davantage centrée sur la peur de la maladie que sur la création active de santé.
Les campagnes de communication, souvent anxiogènes ou culpabilisantes, n’aident pas : 26 % des sondés les jugent trop stressantes, et un tiers préfèrent « ne pas anticiper des problèmes de santé ».
La France reste donc prisonnière d’un modèle où l’évitement de maladie n’est pas un choix de vie, mais une réaction à la maladie.
D’autre part, seuls 17 % des Français citent un « bilan de santé digital » comme levier de motivation.
Le contraste avec les autres pays
L’analyse du Lancet (Bennett et al., 2025) sur 185 pays montre que la France a certes réduit la probabilité de mourir d’une MNT avant 80 ans de 26,8 % à 19,5 % entre 2001 et 2019, mais le rythme de progrès a nettement ralenti : – 5,9 points entre 2001-2010, contre seulement – 1,5 entre 2010-2019.
À titre de comparaison :
- la Finlande affiche une baisse de – 6,7 points entre 2001-2010 et – 2,5 ensuite ;
- la Suisse, de – 3,5 et – 2,3 ;
- le Canada, de – 4,6 et – 2,2 ;
- tandis que la Nouvelle-Zélande atteint encore – 4,9 points dans la dernière décennie.
Autrement dit, la France progresse moins vite que ses pairs, et le ralentissement est plus marqué. Voir le détail de l’étude ici.
Les solutions possibles dans les études scientifiques
Les recherches les plus récentes confirment que la prévention efficace ne dépend plus de la bonne volonté individuelle, mais du design des environnements de décision. Des revues systématiques publiées dans JAMA Network Open (2024), Nature Digital Medicine (2025) ou encore BMJ Open (2024) montrent que les stratégies qui modifient les contextes d’action — rappels intégrés dans les dossiers médicaux électroniques, nudges dans les parcours de soins, applications numériques fondées sur des behavior change techniques — produisent des résultats tangibles sur l’adhésion, la vaccination ou l’activité physique. En revanche, les dispositifs purement informatifs ou moralisateurs ont un impact limité, voire nul, sur la santé réelle.
Parmi les points clés à retenir :
- L’engagement décroît rapidement si le design n’inclut pas renforcement social et support humain (voir l’étude)
- Des méta-analyses récentes confirment que les DBCIs (apps, wearables, SMS, plateformes web) produisent des effets statistiquement significatifs sur l’activité physique, la réduction de la sédentarité et certains indicateurs biométriques — à condition d’intégrer explicitement des behavior change techniques (BCTs), personnalisation, feedback et architecture d’engagement. L’effet est plus fort quand les interventions ciblent la formation d’habitudes et la répétition, et quand elles combinent support humain et technologie. (voir l’étude)
Conclusion
Les Français savent, mais n’agissent pas. Ils adhèrent aux principes, mais restent prisonniers d’un système qui valorise le soin, pas la santé.
FAQ
H3 — Pourquoi les Français croient-ils à la prévention mais n’agissent-ils pas ?
Parce que leur cerveau émotionnel sous-estime le risque futur et privilégie le confort présent. C’est le biais d’optimisme et la préférence pour le présent : nous savons ce qu’il faut faire, mais notre biologie cognitive nous pousse à différer.
H3 — Qu’est-ce qu’un biais cognitif en santé ?
C’est une distorsion inconsciente du raisonnement qui influence nos décisions de santé. Par exemple, penser qu’un infarctus « arrive aux autres » ou que « tant que je me sens bien, tout va bien » relève d’un biais d’optimisme.
H3 — Pourquoi les campagnes de prévention classiques échouent souvent ?
Parce qu’elles reposent sur la peur ou la morale, alors que ces émotions déclenchent souvent l’évitement ou le déni. Les campagnes efficaces utilisent au contraire le plaisir, l’humour, la simplicité ou la valorisation sociale.
H3 — Comment les autres pays réussissent-ils mieux ?
Les pays comme la Finlande, le Canada ou la Nouvelle-Zélande mobilisent les sciences comportementales : nudges dans les environnements de vie, prévention numérique, incitations positives et approches communautaires.
H3 — Que peut faire la France pour combler ce retard ?
Investir dans la prise en charge préventive, comportementale, intégrer les neurosciences dans la communication santé, renforcer l’éducation émotionnelle à la santé dès l’école, et faire de la prévention une pratique gratifiante, pas culpabilisante.