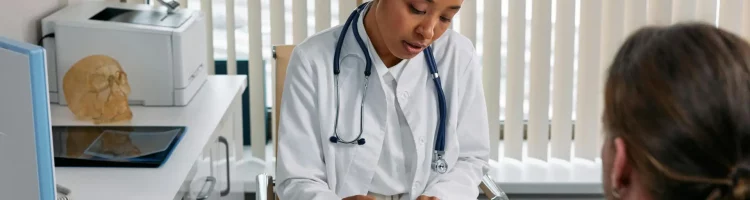La survie au cancer ne marque pas la fin des enjeux de santé : maintenir ou adopter un mode de vie actif après le traitement est reconnu comme un pilier pour améliorer la qualité de vie, prévenir les rechutes et limiter les comorbidités (ex. maladies cardiovasculaires). Pourtant, de nombreux survivants peinent à maintenir une pratique régulière d’activité physique.
L’étude qualitative de Aumaitre et al. (2025), « Facteurs influençant le style de vie actif dans l’après‑cancer », explore les perceptions et expériences des survivants pour identifier les facilitateurs et obstacles à une activité durable.
En parallèle, la littérature quantitative et les recherches sur les interventions numériques mettent en lumière des mécanismes — comportementaux, environnementaux, technologiques — pouvant favoriser la transition et la pérennité d’un mode de vie actif.
Cet article propose une synthèse intégrée, dans l’esprit d’une “science translationnelle”, reliant les voix des patients et les preuves d’efficacité des interventions.
Facteurs facilitateurs et obstacles : recoupements entre perceptions et preuves
Motivation, « nouveau départ » et identité active
Dans l’étude de Aumaitre et al., de nombreux participants décrivent la fin du traitement comme une rupture qui leur offre l’occasion de “réinventer” leur vie — une source de motivation forte à changer leurs habitudes. Cette perception rejoint le concept de teachable moment souvent évoqué en promotion de la santé, selon lequel les transitions de vie (diagnostic, traitement, rémission) rendent les individus particulièrement susceptibles de s’engager dans un changement comportemental. Cependant, cette impulsion initiale est fragile si elle n’est pas encadrée par un système de soutien durable.
Le rôle de l’identité — c.-à-d. intégrer l’activité physique comme partie de soi (“je suis un survivant actif”) — apparaît comme un levier psychologique central. Cela rejoint les théories du changement du comportement (par exemple le modèle social cognitif), où l’auto‑efficacité et la construction d’une identité de personne active soutiennent la persistance dans le temps.
Soutien social et accompagnement humain
Les survivants interrogés soulignent l’importance du soutien familial, de pairs ou de groupes de survivants pour entretenir la motivation et réduire l’isolement. Cet élément est largement confirmé dans les méta‑analyses d’interventions physiques : les BCT (Behavior Change Techniques) de social support (unspecified) sont fréquemment associés à des effets positifs. Par exemple, dans la revue de Grimmett et al. (2019), les interventions efficaces ont souvent inclus une composante de soutien social non spécifiée.
Mais le simple soutien moral ne suffit pas : l’étude de Aumaitre identifie aussi la nécessité d’un accompagnement structurel — suivi post‑traitement, prescription d’activité par le médecin, contacts réguliers — pour éviter que les survivants ne soient « livrés à eux‑mêmes » une fois le traitement terminé.
Capacité physique, fatigue, personnalisation
Parmi les barrières citées, la fatigue persistante, les effets secondaires (douleurs, limitations, neuropathies), et l’absence de recommandations personnalisées (par rapport à l’état physique) reviennent souvent. Ces contraintes physiologiques constituent une limite réelle à l’engagement.
Dans la littérature, on observe que les interventions moins efficaces sont souvent appliquées à des populations plus âgées ou avec des limitations physiques, avec peu de contacts ou sans adaptation progressive. Par exemple, Grimmett et al. notent que les interventions ayant échoué étaient moins susceptibles de comporter action planning, graded tasks, ou support social.
De même, la revue de Finne et al. (2018) identifie que les BCT d’auto‑surveillance (self-monitoring), de fixation d’objectifs (goal setting) et de planification (action planning) sont parmi les plus fréquemment utilisés dans les interventions visant à augmenter l’activité physique chez les survivants.
Enfin, une étude sur les survivants de cancer colorectal (CRCS) a montré que les interventions combinant activité physique et BCT entraînaient un effet positif, même à long terme (SMD ≈ 0,22 sur 3 à 12 mois).
Environnement, accessibilité et intégration dans le quotidien
Un point que l’étude de Aumaitre met en avant est l’importance de l’accessibilité des infrastructures : proximité des équipements, transport, coût, horaires — des facteurs logistiques décisifs.
Les études de maintien comportemental insistent sur la nécessité d’un environnement favorable pour convertir la motivation en action durable. En l’absence d’un cadre infrastructural compatible, même les participants les plus motivés risquent de décrocher.
Un aspect complémentaire est l’intégration de l’activité dans les routines quotidiennes — par exemple via la marche, les trajets actifs, les tâches domestiques — plutôt que d’envisager l’exercice comme une séance “optionnelle”. Ce qui rejoint le constat de l’étude de Aumaitre selon lequel les survivants les plus stables combinent plusieurs facilitateurs (auto‑efficacité, soutien, accessibilité, identité).
Que sait-on des interventions numériques (e‑santé, mHealth, wearables) dans ce contexte ?
L’ère du numérique offre de nouvelles opportunités pour soutenir les survivants de cancer, mais les succès sont nuancés : l’efficacité dépend fortement de la conception, du contexte et de l’intégration humaine.
Efficacité et limites des interventions numériques
- Une revue récente conclut que les interventions de type digital behavior change interventions (DBCIs) pour promouvoir l’activité physique chez les survivants du cancer du sein sont effectives, bien que l’effet sur les comportements sédentaires soit plus variable.
- Xiao et al. (2024) ont étudié des interventions e‑santé globales (web, applications) et montrent qu’elles sont capables d’augmenter l’activité physique, même si les effets sur la qualité de vie ou les résultats psychologiques sont moins établis.
- Une revue sur les interventions à domicile numériques après traitement (chez les femmes survivantes) suggère qu’elles peuvent améliorer les indicateurs de condition physique, mais que leur acceptabilité, leur engagement sur le long terme et leur généralisation restent des défis.
- Dans le domaine du cancer avancé, les interventions numériques visant à promouvoir l’activité physique ou la nutrition montrent une faisabilité acceptable, mais les preuves d’efficacité restent limitées à ce jour.
Ces résultats montrent que la santé numérique est un outil prometteur mais non magique : son impact dépend de la qualité de l’interface, de l’engagement, de la personnalisation, et surtout de l’accompagnement humain.
L’importance de l’engagement des patients dans la conception
Un point clé souligné par une revue récente porte sur l’engagement des patients (patient engagement) dans la recherche et le développement d’interventions numériques pour survivants de cancer. Ren et al. (2025) montrent que peu d’études ont inclus les survivants comme co‑chercheurs ou parties prenantes, ce qui limite la pertinence, l’accessibilité et l’adoption des outils numériques.
De plus, le design des logiciels doit tenir compte des limitations spécifiques des survivants (fatigue cognitive, neuropathies, déficiences visuelles, «chemo brain») pour garantir l’accessibilité et l’adhésion. À ce propos, un travail récent propose des lignes directrices pour concevoir des applications accessibles et significatives pour les survivants de cancer.
Techniques comportementales et maintien via le numérique
Pour qu’un outil numérique contribue de façon durable à l’activité physique, il doit incorporer des techniques de changement comportemental (BCT) robustes et adaptées :
- La méta‑analyse sur le maintien du changement chez les survivants montre un effet modeste mais significatif (SMD ≈ 0,25 pour MVPA) lorsque les interventions comportent un suivi de ≥ 3 mois après la phase active.
- Des techniques auto‑régulatrices (self‑regulation), comme la fixation d’objectifs, l’auto‑surveillance, la revue de comportement, sont particulièrement prometteuses pour maintenir l’activité à 12 mois (OR ≈ 1,80 dans une étude).
- Edbrooke et al. (2023) soulignent qu’il existe encore un manque d’évidence sur le nombre optimal et la combinaison de BCT pour les survivants de cancer, en particulier pour le maintien comportemental.
- Dans les interventions visant à réduire la fatigue chez les survivants, de Vries‑ten Have et al. (2023) identifient comme BCT prometteuses : goal setting (comportement), instruction sur comment accomplir le comportement, démonstration, pratique comportementale, et source crédible. Le concept de “généralisation du comportement cible” — c’est-à-dire adapter l’activité à différents contextes — est aussi identifié comme pertinent.
Ainsi, un outil numérique bien conçu pour survivants de cancer devrait combiner :
- des modules de planification et d’auto‑surveillance,
- des rappels et prompts (relances) pour entretenir le comportement,
- un module de feedback personnalisé,
- des recommandations adaptatives selon la fatigue ou les fluctuations de santé (idéalement une intervention “just-in-time”),
- et une dimension sociale (forum, groupe virtuel, partage de progrès).
Limites structurelles et défis pratiques
Malgré les promesses, il existe des freins structurels :
- L’engagement dans l’application (taux d’adhésion, fréquence d’usage) est souvent faible, et corrèle mal toujours avec les gains réels.
- La plupart des études ne documentent pas les effets à très long terme (au-delà de 6 à 12 mois).
- Le manque de standardisation des rapports d’engagement, de fidélité des interventions et de description des BCT appliqués complique la synthèse et la reproductibilité.
- Les populations incluses sont souvent très sélectives (jeunes, bien éduqués, déjà partiellement actifs), ce qui limite la généralisation aux survivants plus vulnérables.
- Enfin, l’application numérique ne peut remplacer le soutien humain ni agir sur les contraintes environnementales (infrastructures, accessibilité, transport) ou les inégalités socio‑économiques.
Vers un modèle intégré d’intervention post‑cancer : propositions et enjeux
À partir des enseignements de l’étude de Aumaitre et al. et des travaux quantitatifs, il est possible de dessiner les grandes orientations pour concevoir des interventions efficaces et durables :
- Approche centrée sur le patient
- Impliquer les survivants dès les phases de conception (co‑design, feedback utilisateur) pour garantir la pertinence, l’utilisabilité et la motivation.
- Adapter l’interface à leurs particularités (fatigue cognitive, neuropathies, déficiences visuelles).
- Multimodalité : digital + humain
- Associer l’outil numérique à un accompagnement humain (coach, kinésithérapeute, groupe, pair aide) pour combiner automatisation et soutien personnalisé.
- Intégrer le système numérique dans le parcours médical (prescription, suivi par le médecin, relais post‑trouble).
- Incorporation explicite des BCT efficaces
- Intégrer des modules de goal setting, self-monitoring, plans d’action gradués, feedback adaptatif, relances / prompts.
- Utiliser des prompts just‑in-time (adaptés selon la fatigue, le contexte) pour anticiper les baisses de motivation.
- Développer des stratégies de généralisation du comportement (adapter l’activité à divers contextes, varier les modalités).
- Suivi à long terme et maintenance comportementale
- Prévoir des phases relais (post-intervention) avec rappel, suivi, contacts réguliers pour éviter l’“effet rebond”.
- Mesurer et ajuster les interventions sur la durée (12 mois, 24 mois), pas seulement sur la période active.
- Identifier les profils de participants à risque d’abandon (faible motivation, fatigue élevée, gains de poids, historique tabagique) pour cibler des soutiens renforcés. Par exemple, dans l’étude de Mazzoni et al., la mise en place de BCT auto‑régulatrices a permis un maintien de l’activité à 12 mois (OR = 1,80) pour les bénéficiaires.
- Renforcer l’environnement favorable
- Assurer l’accessibilité physique (proximité, transport, horaires) des infrastructures.
- Encourager l’activité dans le cadre du quotidien (marche, déplacements actifs).
- Veiller à l’équité d’accès — populations à bas revenus, zones rurales ou défavorisées ne doivent pas être exclues.
- Évaluation rigoureuse et transparence
- Décrire précisément les BCT utilisés via des taxonomies standard (ex. BCT v1).
- Rapporter les données d’engagement, de fidélité, d’usage de l’outil, et les lier aux résultats comportementaux.
- Concevoir des RCT ou des designs innovants (essais au sein de cohorte, essais adaptatifs) pour tester différentes combinaisons d’éléments. Par exemple, un essai récent dentro du Cancer Prevention Study‑3 applique un modèle d’intervention numérique en “trial within cohort”.
Conclusion
L’étude qualitative de Aumaitre et al. (2025) offre une fenêtre précieuse sur les expériences, motivations, freins et aspirations des survivants de cancer à maintenir un mode de vie actif. En la confrontant aux preuves issues de la recherche comportementale et numérique, on perçoit clairement que le changement durable exige une architecture intégrée, qui allie :
- une dimension psychologique et identitaire (auto‑efficacité, identité d’acteur) ;
- un soutien social et un accompagnement structuré ;
- des interventions numériques conçues avec soin (accessible, engageantes, adaptatives) ;
- une stratégie comportementale rigoureuse (BCT efficaces, suivi long terme) ;
- une prise en compte de l’environnement matériel et des inégalités d’accès.